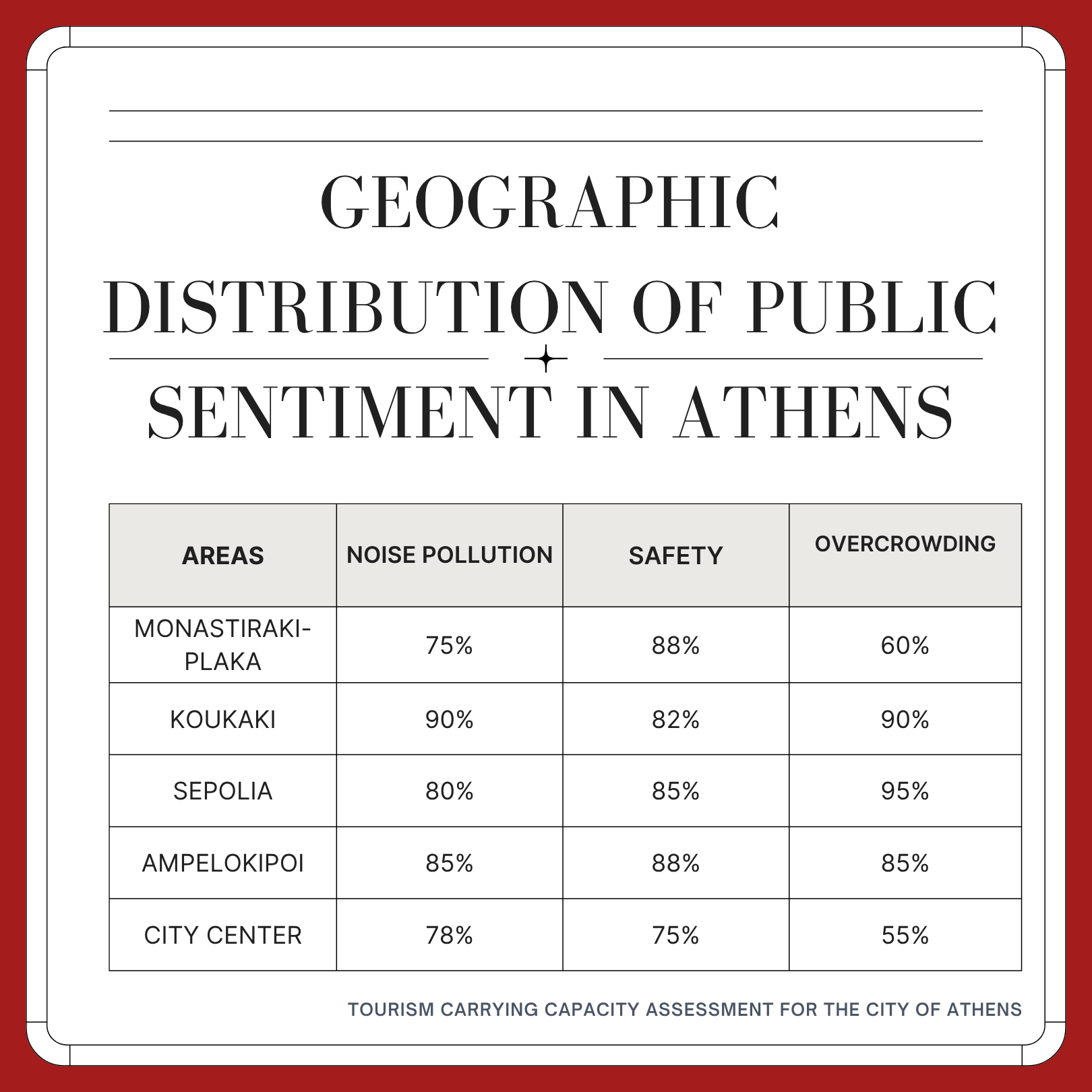La Méditerranée en quête de coexistence
Un nouveau clivage social se dessine dans les rues, sur les balcons et dans les décisions d'urbanisme : le droit de « vivre » versus le droit de « visiter ». Les voix des habitants qui se révoltent contre le surtourisme ne rejettent pas le concept d'hospitalité, mais le modèle qui le dénature. Le tourisme n'est pas l'ennemi ; il le devient lorsqu'il est privé des garanties politiques et institutionnelles qui lui permettraient de coexister avec les communautés locales (5) ; (6) ; (7) .
La Méditerranée est appelée à se repenser – non pas comme un lieu de villégiature ouvert et tout compris, mais comme un lieu de racines culturelles, de pratiques quotidiennes et de continuité historique. La nécessité d'un nouveau « contrat social d'hospitalité » est plus urgente que jamais. Ce contrat devrait inclure :
- Un cadre institutionnel pour limiter les locations de courte durée, avec une distinction claire entre résidences touristiques et résidences permanentes.
- Critères sociaux dans l'urbanisme et l'octroi de licences hôtelières pour éviter la surpopulation de visiteurs dans les centres historiques ou résidentiels.
- Investissement dans des infrastructures touristiques abordables qui ne poussent pas les visiteurs vers des plateformes non réglementées.
- Processus décisionnels participatifs qui intègrent les témoignages et les besoins des communautés locales.
- Campagnes de sensibilisation, non seulement auprès des touristes mais aussi auprès des autorités municipales et des entreprises d'accueil, sur le concept de durabilité mutuelle.
La crise du tourisme n'est pas seulement une question de « quantité » – c'est avant tout une question de qualité des politiques. Si la Méditerranée veut rester un lieu vivant et non un parc d'attractions, elle doit veiller à ce que « visiter » ne nie pas « l'appartenance ». L'ironie est que l'histoire du tourisme elle-même a généralement été caractérisée comme un outil de connaissance, d'échanges interculturels et de mobilité sociale. Aujourd'hui, cependant, ce fil historique semble avoir été violemment rompu, la transformation du tourisme, d'un moyen de contact à une industrie d'exportation d'expériences, entraînant une nouvelle colonisation de l'espace. Une rééducation est nécessaire, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les politiques qui définissent où s'arrête le regard du visiteur et où commence le quotidien du résident.
Si les nobles du Nord parcouraient autrefois le Sud de l'Europe dans le cadre du Grand Tour pour acquérir du capital culturel, les voyageurs du tourisme de masse d'aujourd'hui ne sont pas si différents : ils collectionnent des moments et des images, transformant les quartiers en décors consommables. De même que le Sud était autrefois un objet d'appropriation, il se vide aujourd'hui de son contenu local. Le regard du visiteur ne rencontre pas l'autre, mais le contourne. Les pratiques quotidiennes, les interactions sociales, et même les tensions de la coexistence, s'évaporent pour laisser place à une représentation stérile de l'« authentique ». L'expérience touristique se transforme en souvenir culturel, laissant derrière elle le silence. Si nous ne réinventons pas le sens de l'hospitalité comme relation, et non comme produit, alors la notion même de lieu disparaît.

Photo d'Arno Senoner sur Unsplash